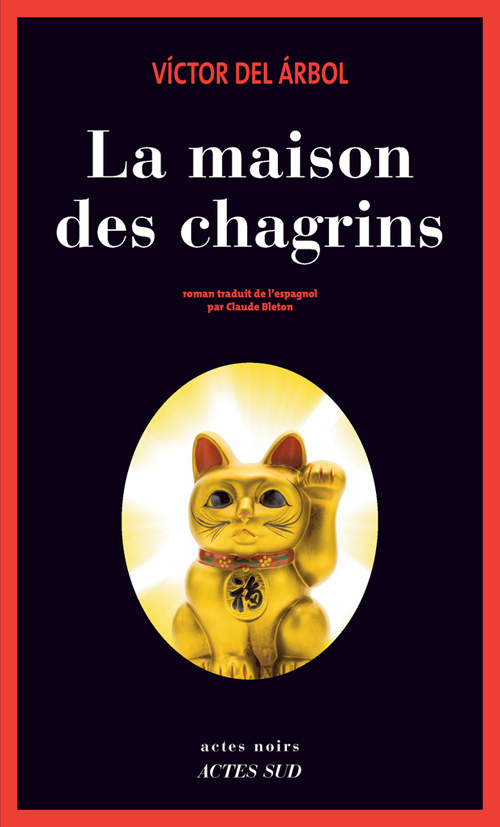Eduardo est peintre. Il aurait pu être un très grand peintre mais il se contente désormais, lorsqu’il n’est pas complètement saoul ou abruti par ses antidépresseurs, de réaliser des portraits sur demande. Car Eduardo a fait 13 ans de prison pour avoir tué l’homme responsable de la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture.
Lorsque sa galeriste lui transmet un nouveau contrat, il n’est d’abord pas très enthousiaste à l’idée d’accepter. En effet, une artiste connue lui demande de réaliser le portrait de l’homme qui a tué son fils dans un accident de voiture et qui vient d’être remis en liberté.
Mais Eduardo sent se tisser un lien avec cette femme qui connaît la même souffrance que lui, sans savoir qu’il vient de prendre un chemin tortueux qui le mènera à croiser d’autres destins, d’autres souffrances à travers une trame hasardeuse qui les relie tous.
Le nouveau roman de Victor Del Árbol était plutôt attendu. Du moins, par ceux qui avaient lu son premier, La Tristesse du Samouraï, et aussi par ceux qui n’ont pas lu celui-ci mais qui ont une amie l’ayant lu et ayant o combien rabâcher le fait que c’était «juste magnifique». Vous l’aurez peut-être compris, je me situe dans la deuxième catégorie. Du coup, n’ayant toujours pas lu La Tristesse du Samouraï (vous comprenez, des choses à faire, des gens à voir, d'autres romans à lire!), j’étais curieuse de voir ce que donnerait le nouveau.
Et bien avant toute chose et encore une fois, il convient de préciser que : ami de la dépression, ce livre n’est peut-être pas fait pour toi. (D’ailleurs, puisqu’on en parle, ami de la dépression, peut-être que tu devrais arrêter de fréquenter ce blog car ici, dépressif ou pas, on aime souvent les textes sombres voire très sombres.)
Bref!
Le destin (!?! Non je déconne, c’est le hasard!) a voulu que, peu de temps après avoir fini ce roman, je vois une série télé (Touch) dont le concept repose sur l’idée que certaines personnes sont reliées entre elles par un fil invisible, une sorte de destin commun avec effet papillon. Et bien étrangement, c’est la base même du roman de Victor Del Árbol. La comparaison s’arrêtera là.
Bien qu’il soit paru en Actes Sud noirs, La Maison des Chagrins n’est pas un roman policier mais plutôt un roman noir. Ne vous attendez donc pas à une quelconque enquête ou un quelconque effet de suspens, il n’y aura aucun des deux.
Et puisqu’on parle de Actes Sud, il faudrait qu’on m’explique comment on passe de ça :
à ce titre foireux La Maison des Chagrins. Parce que du chagrin, ok, mais de maison, que nenni! Mais bon, passons, les voies de l’édition sont souvent impénétrables!
La Maison des Chagrins est un roman choral. Vous connaissez le principe : plein de personnages qui a priori ne se connaissent pas et qui finissent tôt ou tard par se croiser (et pas forcément dans la même maison, enfin je dis ça...). De ce point de vue là, le roman est idéalement conçu. Peut-être trop idéalement. Victor Del Árbol pousse tellement loin cet effet de construction, qu’on finit par se dire qu’effectivement, la vie possède un sens de l’humour assez particulier.
Les personnages sont variés avec une psychologie assez approfondie et pourtant ils sont tous construit de manière identique : chacun est une sorte de cabossé de la vie qui va découvrir peu à peu que la vérité n’est jamais que celle que l’on veut bien prendre comme telle; tous sont dévorés par un désir de vengeance et c’est cette volonté de vengeance qui finira par tous les relier et qui permettra à l’histoire de prendre toute son ampleur car au final, tous sont à la fois victime et bourreau.
«N’avons-nous pas tous un monstre en nous? Qui attend le bon moment pour se débarrasser de cette fausse peau qui le dissimule.»
Victor Del Árbol aborde ainsi la question de savoir jusqu’où peut-on pousser son désir de vengeance. Et lorsqu’il disparaît, laisse-t-il autre chose qu’un vide si profond que rien ne peut venir le combler?
«A quoi sert la douleur, si on ne peut la partager avec celui qui te l’inflige? Je ne suis pas là pour pardonner, Eduardo. J’ai besoin de comprendre, et j’ai besoin de haïr.»
Victor Del Árbol déroule son histoire avec une écriture simple, sans envolée lyrique mais parsemée par-ci par-là de petites fulgurances.
«Cette femme parlait par les yeux, et ses brefs battements de paupières étaient autant de points et de virgules.»
Ainsi, on pourrait croire que j’ai adoré ce livre ou tout au moins beaucoup aimé. Et pourtant...Il s’avère que d’un point de vue «clinique», strictement professionnel («l’oeil du libraire»), j’arrive à voir, je sais même, que ce roman est bon, bien construit, bien écrit, bref, maîtrisé de bout en bout. Mais je dois dire que je n’ai été touchée par aucun personnage, aucun ne m’a émue, rien, pas une goutte d’empathie. Et quand on doit vraiment chercher longtemps pour trouver ce qu’on pourrait dire sur un roman, ce n’est généralement pas bon signe. Toutefois, il s’avère également que dernièrement, La Maison des Chagrins n’est pas le seul roman a avoir eu cet effet sur moi ou devrais-je dire à n’avoir eu aucun effet sur moi alors que tous les ingrédients étaient là pour que je puisse l’aimer.
Alors quoi? Et bien rien. Eh, oui, je vais juste lâchement vous laisser vous démerder avec ça!