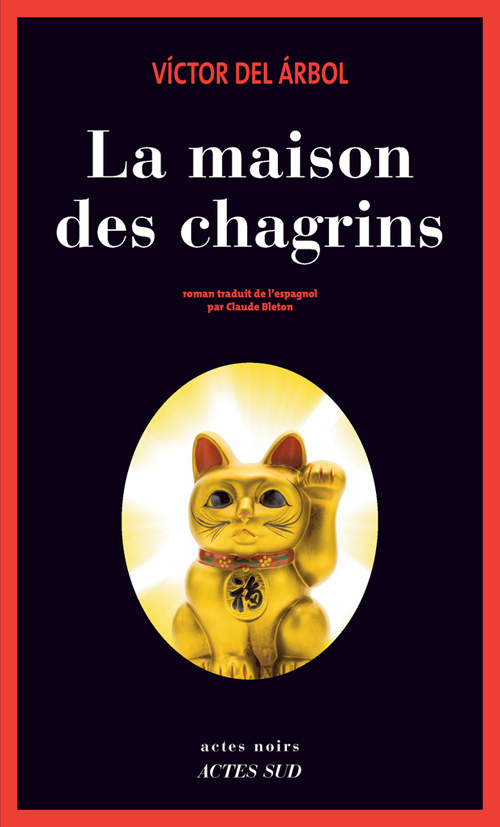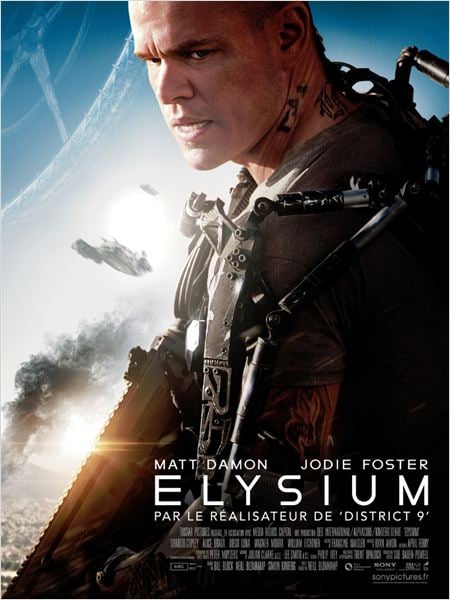Dans un précédent épisode, précédant le précédent du précédent pour remonter à celui d’encore avant, je vous avais déjà dit tout le bien que je pensais d’une petite maison d’édition nommée Dystopia responsable entre autres forfaits de deux petits bijoux (pour ne pas encore répéter au risque déjà produit de le galvauder, le terme de chef-d’oeuvre) estampillés pour l’un Lisa Tuttle (traduite et présentée par Mélanie Fazi) et pour l’autre Yves et Ada Rémy, et encore coupable d’un autre excellent toujours signé Yves et Ada Rémy.
Et bien, on ne continuera jamais assez (et nonobstant tout autre superlatif) de dire du bien d’eux pour nous proposer Cru, recueil de nouvelles de Luvan, surprenant, désarçonnant à plus d’un titre mais sans contestation possible la révélation d’une auteure qui n’en est pourtant pas à son coup d’essai en terme d’écriture (je vous incite fortement à visiter son site où l’on retrouve de manière ludique son travail aussi divers que varié).
A la différence de Ainsi naissent les fantômes, Cru n’est pas un recueil de nouvelles à chutes mais tout comme Lisa Tuttle, Luvan possède le don de savoir mettre en exergue les ambiances, le mystère et une certaine noirceur.
A l’image de sa couverture (encore une réussite de Stéphane Perger), Cru est sombre tout en possédant une certaine luminosité. Il se lit comme on explore une pièce plongée dans le noir, armé seulement d’une lampe torche. On avance à tâtons découvrant les éléments sans trop comprendre où l’on va. Luvan construit en pointillisme. Elle donne l’impression de jeter les éléments par bribes, par morceaux, comme ils viennent. Elle nous lâche et nous égare pour mieux nous récupérer à la fin. Certains abandonneront bien avant cette fin en râlant n’y rien comprendre et c’est dommage pour eux.
Certaines nouvelles m’ont moi-même perdue au sens où je ne suis pas certaine de les avoir bien comprises (comme Le Tunnel ou Carmilla dont le côté poétique étouffe peut-être un peu l’histoire contée), mais en grande majorité, elles m’ont littéralement enveloppée (comme Le Brise-glace où chaque son semble sortir du livre) voire hypnotisée (comme Moroï ou La Femme Verte). Mon coup de coeur va sans doute possible à deux nouvelles en particulier : Le Pacte, nouvelle sur l’attachement et le sacrifice, et Le Rapt (l’amour n’est-il qu’une question de possession? Non, je ne vous en dirai pas plus), la dernière nouvelle, la plus longue, magnifique qui justifie à elle seule l’achat du recueil.
Luvan sait parfaitement teinter son écriture de poésie et d’émotions, mais surtout, Luvan possède une écriture sonore : le bruit de la neige, le craquement de la glace, celui d’une cigarette en train de se consumer, le bruit de la nuit, le son d’une respiration rauque, les nouvelles de Luvan s’entendent autant qu’elles se lisent.
Cru fait partie de ces lectures qui ne s’offrent pas d’elles-mêmes mais qui se méritent. Sa beauté est comme celle de certaines femmes, visible uniquement dans le vécu, dans l’expérience. Un peu comme croiser une femme charmante. Sur le moment, on se dit qu’elle est belle mais c’est lorsqu’on s’arrête réellement, qu’elle se met à bouger, à parler, à sourire, qu’on se rend réellement compte de l’étendue du charme et alors, il est déjà bien trop tard, on est littéralement subjugué.
Cru est ainsi. Il subjugue. C’est l’un de mes coups de foudre de l’année et chaque relecture me fait l’aimer d’avantage. Car Cru n’est pas un recueil qui se lit mais qui se relit pour qu’ainsi, il prenne toute son ampleur et son emprise sur le lecteur.
Que dire sinon un merci tonitruant aux éditions Dystopia pour avoir rendu tangible ce recueil dans un objet encore une fois parfait, et bien entendu à Luvan, première responsable et qui fait partie de ces talents qui, dans une recrudescence de littératures cruellement fades et toutes interchangeables, s’incrustent, bousc(r)ulent et prouvent que oser, c’est bien, l’audace c’est encore mieux pour un plaisir toujours accru.
Incruyable, non? Je vous l’avais dit!